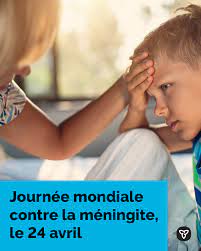La journée mondiale contre la méningite coïncide avec la semaine européenne de la vaccination.
Les méningites sont une inflammation des méninges constituées de trois membranes protégeant le système nerveux central (cerveau, cervelet, tronc cérébral et moelle épinière).Elles proviennent d’une infection du liquide céphalorachidien (liquide circulant entre les méninges), généralement due à un virus. Dans certains cas, une bactérie, un champignon ou un parasite peuvent aussi être en cause.
Les méningites virales sont les plus fréquentes
Dans ce type de méningite, certains symptômes appelés « syndrome méningé » (céphalées, photophobie et vomissements) sont dominants, et l’état général de la personne n’est pas altéré.
La maladie est en général bénigne : chez les patients ne souffrant pas d’un déficit immunitaire, le rétablissement se révèle le plus souvent spontané. La guérison intervient alors sans séquelles, au bout de quelques jours.
Elles sont dues, le plus souvent, à des virus très répandus, appartenant à la famille des entérovirus. Un syndrome méningé peut aussi être présent dans d’autres maladies virales :
- la varicelle ;
- un zona ;
- la rougeole ;
- les oreillons ;
- la primo-infection au VIH ;
- un herpès (chez les personnes présentant une immunodépression).
Les méningites bactériennes, moins fréquentes mais plus graves
En France, le nombre de méningites bactériennes a été estimé à 1 448 cas en 2012. Elles représentent 20 à 25 % des méningites dites communautaires (survenant dans des conditions de vie habituelles).
Après une infection locale, respiratoire (pneumonie) ou oto-rhino-laryngologique (rhinopharyngite, angine, otite, sinusite, etc.), les bactéries présentes dans le rhinopharynx peuvent passer dans le sang, et éventuellement infecter le liquide céphalo-rachidien.
Le syndrome méningé est alors souvent associé à un syndrome infectieux grave (dysfonctionnement des organes et de la circulation du sang).
En l’absence de traitement rapide, ces méningites bactériennes peuvent :
- atteindre d’autres parties du système nerveux central comme le cerveau, le cervelet ou le tronc cérébral (on parle alors de « méningo-encéphalite) ;
- toucher l’ensemble de l’organisme (infection généralisée ou « septicémie »). Dans ce cas, la maladie est dite « invasive ».
La méningite bactérienne est une urgence médicale, et le traitement doit être mis en œuvre rapidement.
Ces méningites sont déclenchées par diverses bactéries.
Le pneumocoque
La méningite à pneumocoque (environ 700 cas par an en France) peut survenir chez l’enfant, mais plus souvent chez l’adulte. C’est le germe le plus fréquemment responsable de méningites bactériennes.
Le pneumocoque diffuse par contiguïté à partir d’un foyer infectieux ORL (une sinusite par exemple) ou plus rarement par voie sanguine (par exemple en cas de pneumonie).
Le pneumocoque peut également provoquer des méningites chez des patients souffrant d’une immunodépression (liée à une ablation de la rate, un abus d’alcool chronique, des maladies de sang héréditaires. Il arrive aussi qu’il infecte les méninges à la suite d’un traumatisme crânien, ayant créé une ouverture dans les méninges.
Le méningocoque
Comme son nom l’indique, ce germe provoque essentiellement des méningites. Naturellement présent dans la gorge, il peut devenir nocif en se multipliant, puis en passant dans le sang et les méninges.
En France, les infections graves à méningocoques touchent environ 500 à 600 personnes par an (deux tiers de méningites, un tiers de septicémies), avec un pic de fréquence en hiver. Elles sont responsable de 50 à 60 décès par an. Les personnes les plus touchées sont les enfants de moins d’un an, les enfants entre 1 et 4 ans et les jeunes adultes non protégés par la vaccination de 15 à 24 ans.
La contamination par le méningocoque est interhumaine directe et survient lors d’un contact proche et prolongé avec les sécrétions orales contaminantes. Dans l’immense majorité des cas, la contamination d’une personne n’entraîne qu’une simple colonisation du nez et du pharynx, sans autre conséquence. Exceptionnellement (si le germe est virulent, si la personne est affaiblie…), le méningocoque diffuse dans le sang et colonise les méninges, entraînant une méningite.
Chaque année, la méningite à méningocoque touche environ 500 000 personnes dans le monde. L’Afrique subsaharienne, du Sénégal à l’Éthiopie, enregistre les taux de population touchée les plus élevés (on parle de « ceinture de la méningite »).
La listéria
La contamination se fait par l’alimentation (fromages crus par exemple). La listeria, présente dans le tube digestif, colonise les méninges par le sang. Cette méningite (environ 60 cas par an) est observée chez les femmes enceintes, les personnes âgées, celles abusant d’alcool ou sous traitement immunosuppresseur.
L’haemophilus influenzae et l’escherichia coli
Chez l’enfant de moins de 5 ans, surtout, la méningite bactérienne peut aussi être due à l’haemophilus influenzae (également responsable de pneumonies) ou à l’escherichia coli (ou E. coli).
Les méningites aiguës fongiques ou parasitaires très rares
Les méningites fongiques surviennent surtout chez les personnes immunodéprimées, elles sont dues à des levures (champignons microscopiques) tels que les cryptocoques ou le candida albicans, et apparaissent en cas d’immunodépression. Leurs symptômes sont souvent marqués (ex. : troubles de la vigilance, paralysie des nerfs crâniens).
Très rarement, des parasites comme celui de la toxoplasmose peuvent être en cause.
QUELS SONT LES FACTEURS SUSCEPTIBLES DE FAVORISER L’APPARITION D’UNE MÉNINGITE
La plupart des méningites sont contractées dans les conditions de vie habituelles, sans lien avec une hospitalisation ou un acte médical. On parle alors de « méningites communautaires ». Les nourrissons, enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées et immunodéprimées sont les plus souvent atteints.
Le fait de vivre dans une collectivité fermée, et surtout le fait d’être en contact avec une personne atteinte de méningite, sont des facteurs favorisant la survenue de la maladie.
Chez certains patients, l’infection est contractée lors d’une hospitalisation. On la qualifie alors de « méningite nosocomiale ». Une méningite peut survenir par exemple après une intervention neurochirurgicale ou ORL lorsqu’il y a eu contamination du liquide céphalorachidien par une bactérie.
Certaines méningites surviennent dans le cadre du travail. Elles peuvent être reconnues comme maladies professionnelles.
Source: ameli